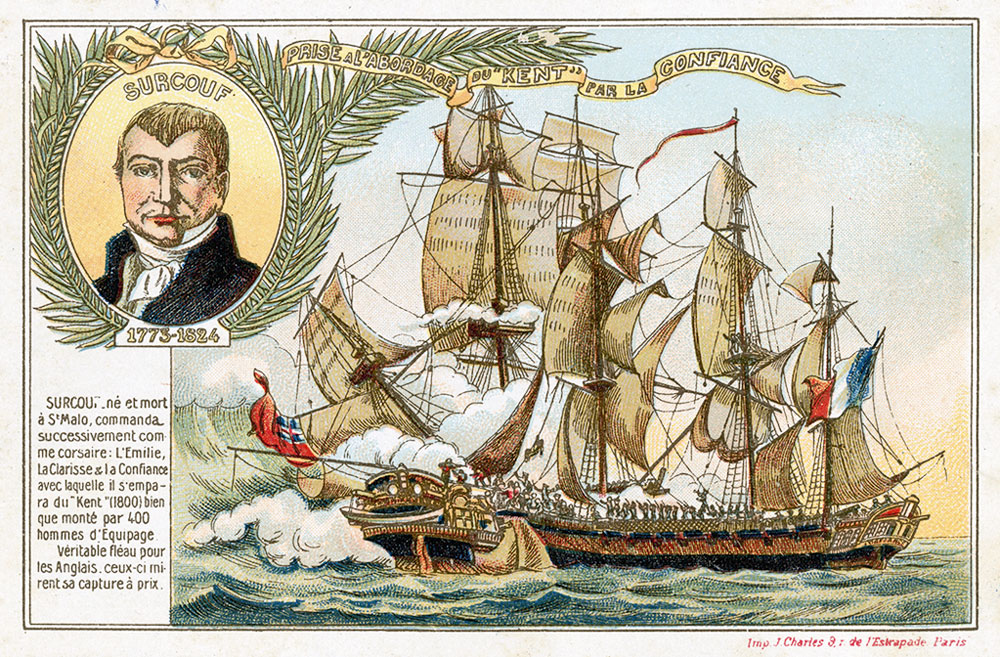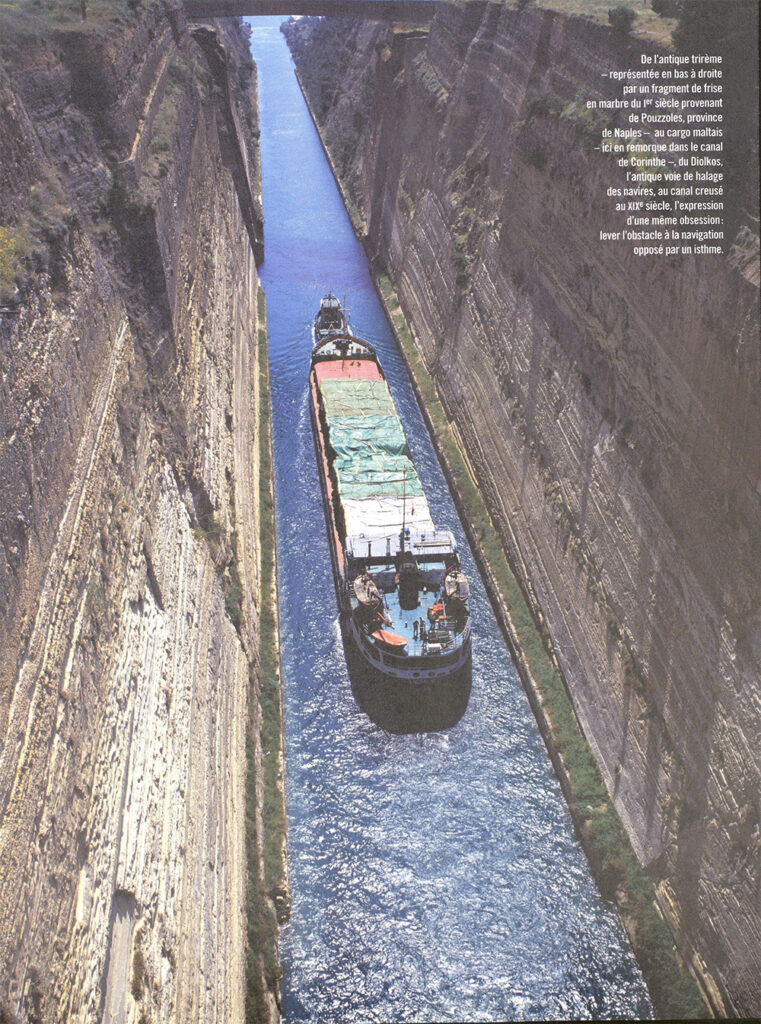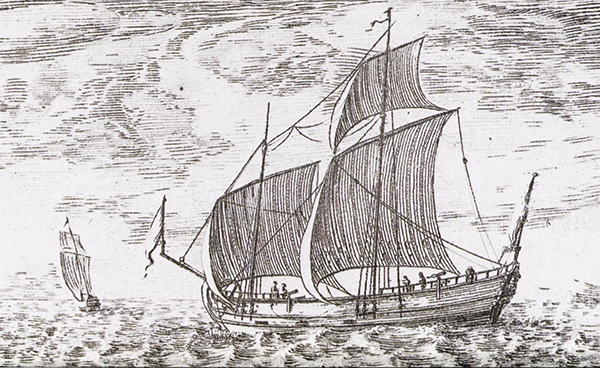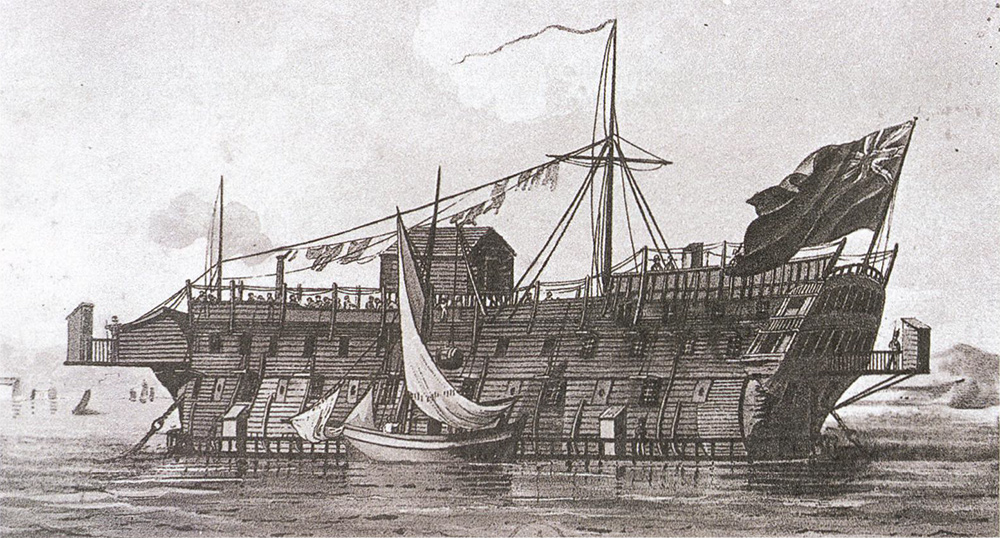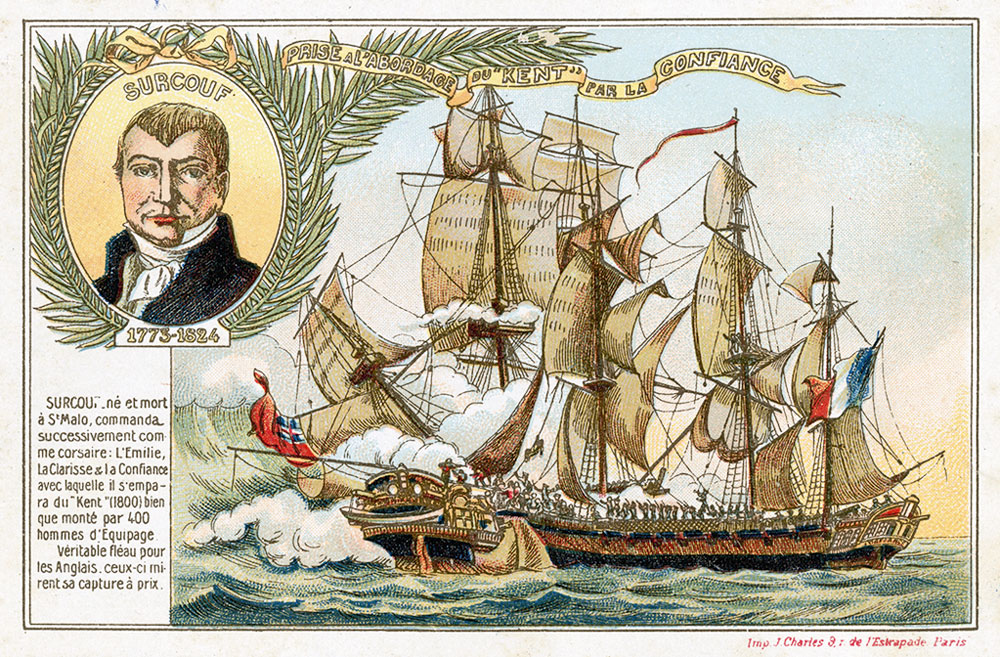
La Confiance, corvette de Surcouf
par Guy Le Moing – Surcouf, le plus grand des corsaires, aux commandes de la Confiance, la plus fine des corvettes :... Read more
Réservé aux abonnés
Retrouvez 40 d'archives et plus de 2500 articles en quelques clics
Découvrir plusComplétez votre collection ou trouver le numéro que vous souhaitez avec nos archives papier
Découvrir