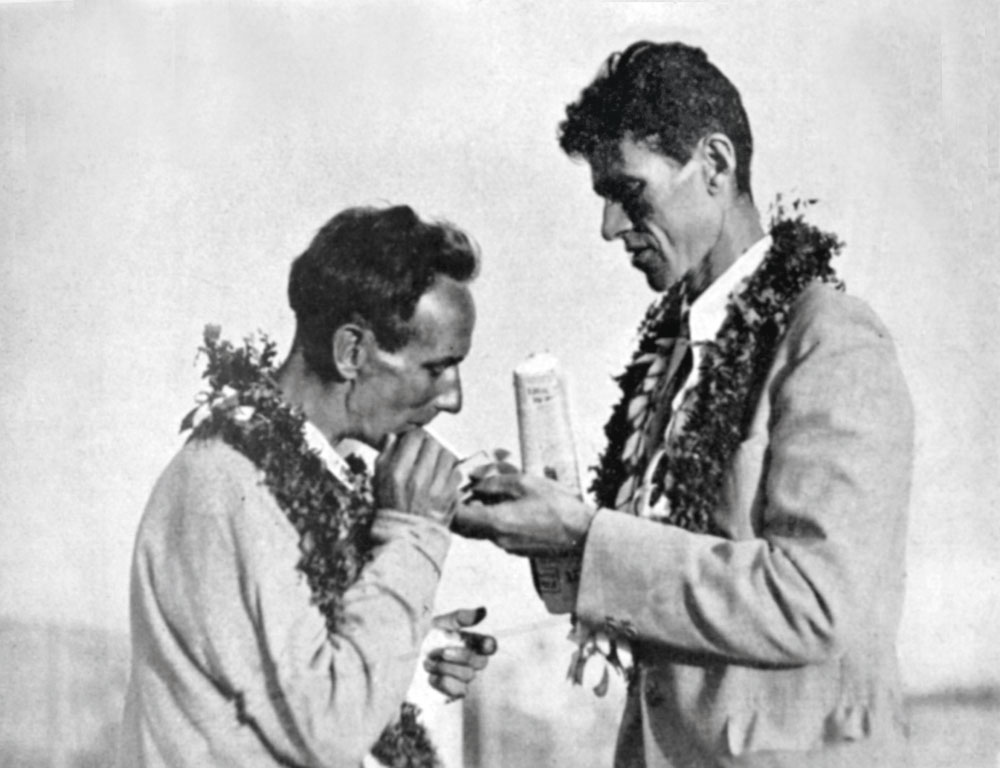par Sébastien Daycard-Heid, photographies de Guillaume Collanges - En France, la pêche manque de marins et recrute de la main-d’œuvre étrangère. Plus de cinq cents Sénégalais travaillent ainsi sur les bateaux bretons, poussés à l’exil par la surexploitation des ressources marines qu’ils subissent chez eux.
L’article publié dans la revue Le Chasse-Marée bénéficie d’une iconographie enrichie.