
Marie-Josèphe Camboulive, dite Miette, habite Marseillan, où Maud Lénée-Corrèze l’a rencontrée. Elle a débarqué du Provence mais reste attachée aux barques du canal du Midi où elle a passé sa vie de marinière. Dessins de Hubert Poirot-Bourdain.
« Nous sommes mariniers de père en fils… depuis 1730 ! J’ai fait la généalogie de la famille pour savoir depuis quand et le premier, c’était un paysan de la banlieue toulousaine qui a quitté sa terre pour devenir marinier. Et moi je suis née sur la barque de mes parents. Et mon fils est marinier ! Hé oui, les chiens ne font pas des chats. On a essayé de le dissuader, mais bon… Son fils aussi aurait bien été marinier, mais là on lui a dit que c’était plus possible, non, ça n’existe plus !
« Oui, car le canal, il est en train d’être perdu. VNF [Voies navigables de France] ne l’entretient plus trop, et du coup, il s’envase, il y a l’herbe qui pousse…. Il n’y a plus d’avenir, et même la plaisance qui avait pris le relais du transport commence à se décourager.
« Mes parents avaient un vieux bateau en bois. J’ai perdu ma maman quand j’avais 5 ans, elle, elle en avait 25. Avec ma sœur qui avait deux ans de plus que moi, on a été élevées par nos grands-parents maternels qui habitaient au Port de l’Embouchure à Toulouse. On a eu de la chance, ma sœur et moi : à notre époque, les enfants allaient en pension. Avant, dans la génération de mes parents, ils partaient vivre dans la famille, mais ça commençait à se perdre.
« Mes grands-parents sont décédés l’année où j’ai eu le BEPC, et ma sœur et moi, on est devenues matelots sur le bateau de notre père. Quand on était petites, notre père nous surélevait pour qu’on prenne la barre franche. Ah ! oui on a connu la barre franche ! La barque s’appelait Marie-Suzanne, je m’appelle Marie et ma sœur, Suzanne, et ça mon père n’a jamais pu le digérer. Son bateau devait s’appeler Suzanne-Joseph, mais il a eu deux filles, alors qu’il avait toujours rêvé d’avoir des garçons.

« D’ailleurs, moi, je m’appelle Marie-Josèphe. Mais bon, personne ne m’a jamais appelée comme ça, les amis, la famille m’appellent Miette : c’était le nom de mon arrière-grand-mère.
« On avait un père, qu’était pas vraiment un père…c’était notre patron. Il nous a élevées à la dure. Il n’a pas eu de fils, mais il a eu des filles matelots. Quand ma sœur et moi avons embarqué définitivement, c’était sur le deuxième bateau de mon père, et il avait une barre à roue. Il nous montrait comment changer un piston du moteur, et après on se débrouillait pour faire le reste toutes seules. On savait entretenir le moteur, l’allumer, arrêter, faire les graissages, sur un moteur de la taille de la table !
« Comme par habitude, les marinières épousent des mariniers, et avec ma sœur, on a épousé des mariniers à deux ans d’écart. Je suis allée sur le bateau de mon mari, ma sœur, sur celui du sien. Et, là, c’était différent déjà. Le Provence, à mon mari, était en fer, avec un logement à l’arrière. à l’époque de mon père, c’était la petite tille dans la pointe avant, on habitait là-dedans…
« Les logements à l’arrière, c’était pratique, parce que ça communiquait avec la timonerie. On avait les enfants avec nous : notre fille handicapée, qui était issue d’un premier mariage de mon mari, et notre aîné, à partir de 1973. Mon mari était à la barre, et donc même à l’écluse, quand moi j’étais sortie, il avait toujours un œil sur les enfants en bas. C’était comme ça, on se mariait entre nous, et après on vivait ensemble sur la barque.

« Le monde des mariniers, c’est une grande famille. Il y avait vraiment une vie sociale entre gens du canal. Les bateaux se retrouvaient tous après un voyage. Le soir, on mettait la table à terre et chacun amenait un peu ce qu’il avait. On avait un besoin de communauté. On s’appelait par le nom de nos barques. Mon mari, c’était pas le petit Camboulive, mais le petit du Provence.
« Et quand on arrivait à une écluse, pendant les journées de travail, il y avait aussi cet esprit de solidarité. Les éclusiers élevaient des poules, on leur achetait des œufs et des légumes, car la maison éclusière avait toujours un jardin avec un potager.
« On était artisans, donc indépendants, mais on avait une coopérative qui regroupait trois cents mariniers et qui s’occupait de nous. Elle faisait nos comptes, car à l’époque, et surtout dans la génération de mon père, beaucoup de mariniers ne savaient pas lire, et à peine écrire leur nom. J’en connaissais un, quand il faisait le carénage et qu’il fallait réécrire le nom de son bateau sur la coque, c’est quelqu’un qui le faisait pour lui…
« Il y a eu un âge d’or au début des années 1970. C’était l’époque où on a fait de l’exportation pour les pays d’Afrique. On transportait des céréales. C’était sans arrêt, sans arrêt. Les céréales du Lauragais, on les transportait jusqu’à Sète ou à Port-La-Nouvelle. Là, le navire nous attendait. Et on repartait aussitôt. On allait jusqu’à Bordeaux, on allait sur le Rhône… On était souvent à trois bateaux, le nôtre, celui de ma sœur et son mari et celui d’amis.
« En 1973, on a eu une opportunité de charger du minerai de Salsigne [de l’or] à Carcassonne qu’on devait porter jusqu’à Avignon. Là, une grosse barge du Rhône qui faisait 500 tonnes, ou quelque chose comme ça, nous attendait. Nous, on portait chacun 120-130 tonnes. On était censé lui rendre la marchandise et repartir chez nous, et lui partait en Allemagne. Sauf que le Rhône était bas : il ne pouvait pas prendre tout. Finalement, le service des affrètements a proposé que le bateau charge une partie de notre cargaison, et qu’il nous remorque jusqu’à Lyon, puisque nous, on pouvait pas remonter le courant. Et à Lyon, le bateau nous rendrait notre marchandise et c’est nous qui irions ensuite en Allemagne. On était jeunes, la vingtaine, et un peu barjo, alors on s’est dit, tiens on va aller en Allemagne ! Et puis, financièrement, c’était intéressant.
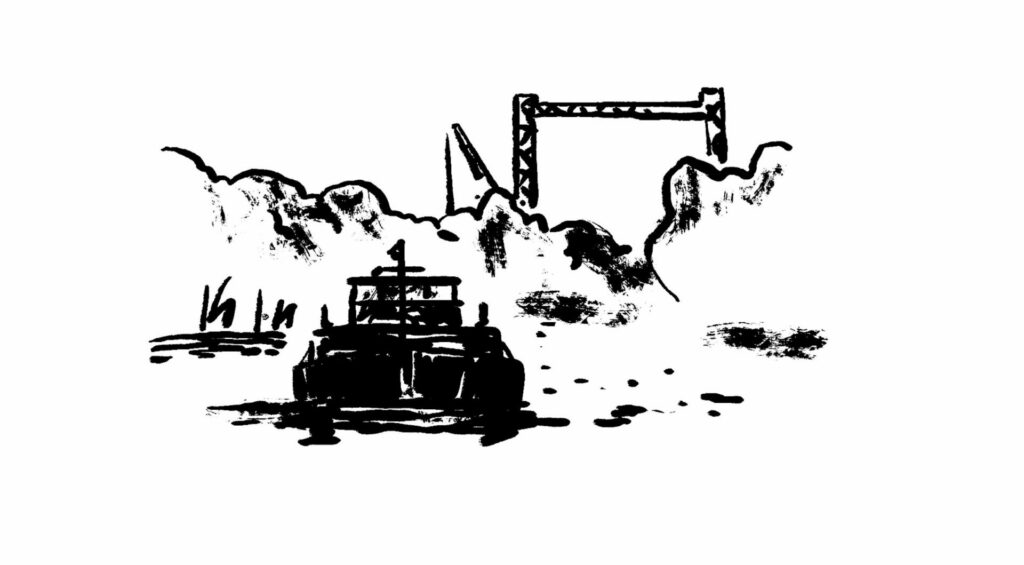
« À partir de Lyon, on s’est débrouillé seul jusqu’à Coblence, où un pilote est monté sur chaque bateau. On a passé une journée entière sur le Rhin. Là-bas, pour nous, gens du petit canal du Midi, c’était une vraie autoroute. D’ailleurs, quand on attendait les pilotes, les gens nous disaient : “Vous allez faire le Rhin avec ça demain ?” Nos bateaux faisaient 30 mètres de long, les leurs 90 mètres ! Avec ma sœur et l’amie, on est allées faire les courses, acheter de l’eau, et ce qu’il fallait pour nos bébés. Thierry, notre premier fils, avait deux mois. Il a mangé sa première soupe en Allemagne.
« On est arrivé à Duisbourg et on a attendu dix jours avant d’être dédouanés. à un moment, on nous a demandé si on ne pouvait pas amener la marchandise à sa destination finale. On a réfléchi, mais ça commençait à faire long. Finalement, on est reparti vers notre petit canal du Midi, où on est très bien !
« Après, le déclin a commencé assez vite. Les affrètements étaient de plus en plus rares. On n’était plus aussi diversifiés que nos parents : eux, ils portaient de tout, c’était un peu l’épicerie ambulante. Mais nous, c’étaient que des céréales et quand ça s’arrête, on n’a rien d’autre, et c’est un peu tard pour aller démarcher des courtiers.
« Bien sûr, il y a eu aussi la concurrence de la route. On a porté des graviers pour construire l’autoroute. Alors on chargeait, on chargeait, et on regardait l’autoroute se construire et puis après on a vu les camions passer ! La SNCF aussi a eu une politique de transport de lourd, elle massacrait les prix. À un moment, on n’a pas pu s’aligner. On est entré dans l’ère de la vitesse, où il fallait les choses, là, tout de suite. Nous, on était à 6 nœuds ! Les camions, les trains, ils transportaient le jour pour le lendemain, à des prix très bas.
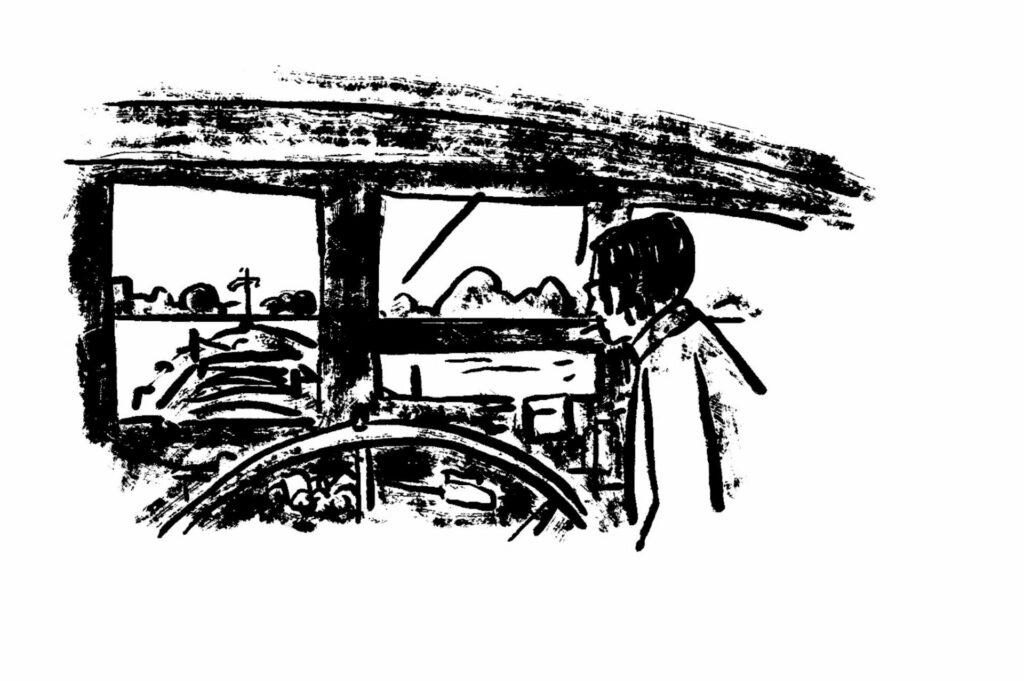
« Alors, avec mon mari, on a été les premiers à se débarquer à la fin de 1973. Un jour, à l’écluse de Bayard [Toulouse], l’éclusier nous dit : “Ils embauchent au canal, ça vous intéresse pas ?” Sur le coup, on a dit non, on était mariniers quoi ! Et puis, réflexion faite, on s’est dit : “Est-ce qu’on aura une opportunité pareille deux fois ?” Le service de navigation proposait des postes dans les écluses déclassées, là où il n’y avait plus assez de trafic, sur le canal latéral. On touchait la moitié du SMIC, mais on était logé gratuitement, et ça, quand on met la valise à terre, c’est énorme. On s’est dit, de toute façon, si c’est pas maintenant, c’est dans quelques années. Les enfants vont grandir, il faut qu’on se stabilise quelque part.
« On s’est donc débarqué et je suis devenue éclusière à Fenouillet, sur le canal de Garonne en banlieue de Toulouse. Mon mari faisait des remplacements d’éclusiers dans le secteur. On a aménagé le bateau en habitation.
« À l’époque, j’étais à l’écluse treize heures par jour, de 6 h 30 à 19 h 30, six jours par semaine. Mais j’étais contente ! On était logé, avec un bout de jardin, des poules, des lapins… On avait le bus pour l’école. J’ai passé le concours pour être titularisée.
« D’ailleurs pour l’anecdote, un jour je rencontre un monsieur du service de navigation qui me dit : “Madame Camboulive, vous êtes allée à l’école ? On a été très étonnés, vous êtes première au concours !” On était quarante… et j’avais pas l’impression d’avoir fait des études !

« Au bout d’un moment, l’écluse, ça commençait à me peser. Alors j’ai essayé le concours de chef d’équipe pour m’occuper de l’entretien d’un secteur. C’était d’un autre niveau financièrement. Ça a été le scandale dans le service : une femme chef d’équipe ! On me dit : “Vous allez avoir que des hommes comme ouvriers !” J’avais une amie, fille de mariniers, que j’appelais souvent et qui avait aussi été à l’école. Elle me dit : “On y va ?” Ça leur plaît pas aux mecs, ça fait rien ! Au niveau de la France, il y avait peut-être des femmes mais pas chez nous… le Midi, quoi !
« On a passé l’oral à Pont-à-Mousson, on était cent quarante, et seulement deux femmes ! Michèle a été première, et moi, deuxième. ça a vexé beaucoup d’hommes. Mais on avait été marinières, on avait l’habitude d’avoir les mains sales, on avait cette culture technique. Qu’est-ce qu’on a pas entendu, quand on est arrivé au concours ! Un des examinateurs m’a dit : “Vous venez à la place de votre mari, madame ?” Sur le coup, t’as une boule au ventre…

« On a donc été chefs d’équipe, mais ça plaisait pas au chef du personnel. Il nous a harcelés, ma copine et moi, pour qu’on passe le concours de commis, un boulot administratif. Moi, ça se passait bien avec les hommes. Si tu leur prouves que tu en sais plus qu’eux, que tu peux leur apprendre, voire que tu es capable de faire le travail à leur place, ça passe.
« Un jour, on m’a appelé : “Madame Camboulive, on est très embêté, on a plus de comptable depuis six mois au bureau de Carcassonne.” Ils avaient tout prévu : le service proposait un poste très intéressant à mon mari, près d’un emplacement pour notre bateau, avec l’eau, l’électricité, tout ! L’école était à côté, et il y avait un centre pour notre fille handicapée. Donc, j’ai été comptable de la subdivision du service de navigation de Carcassonne… Mais j’en ai eu vite marre. Il me manquait l’air des quais, alors j’ai passé le concours de contrôleur pour être responsable d’un secteur, gérer le personnel, les relations avec les riverains, la gestion de l’eau…
« J’ai été contrôleur à Saint-Ferréol, mais après mon mari a eu envie de retourner au pays. Il vient du sud-ouest de l’étang de Thau. J’ai été mutée à Béziers.
« Après avoir passé le concours pour être en catégorie A, je suis allée au Puy-en-Velay à la Direction départementale des équipements, pour les routes. J’ai fait ça un an, avant de retourner dans le Sud, à la dde de Montpellier. C’était différent, mais grâce à ça j’ai pu prendre une retraite anticipée.

« Ça fait douze ans qu’on vit dans cette maison, à Marseillan. C’est fini le canal. Je suis présidente de l’Amicale des mariniers, qui a été créée dans les années 1980 pour garder le lien. Quand il n’y a plus eu de travail sur le canal, chacun a essayé de s’en sortir, de faire sa petite vie. On avait vécu tellement dans un milieu fermé qu’on a eu du mal, les uns et les autres, à se faire une vie à terre. On était trois cents au début dans l’Amicale, là on n’est plus que cinquante. Mais quand on ne sera plus que deux, on se retrouvera quand même !
« Quand on débarque, il n’y a plus cette impression d’appartenir à une famille. Ici, j’ai des voisins, on dit bonjour, on aide un peu la vieille dame en face, mais ça s’arrête là. Et le canal, il perd de son attrait, il va sans doute devenir un canal d’irrigation. On reviendra pas en arrière, au temps du transport. C’était une vie trop différente. Si t’es pas né là, tu t’habitues pas… »




