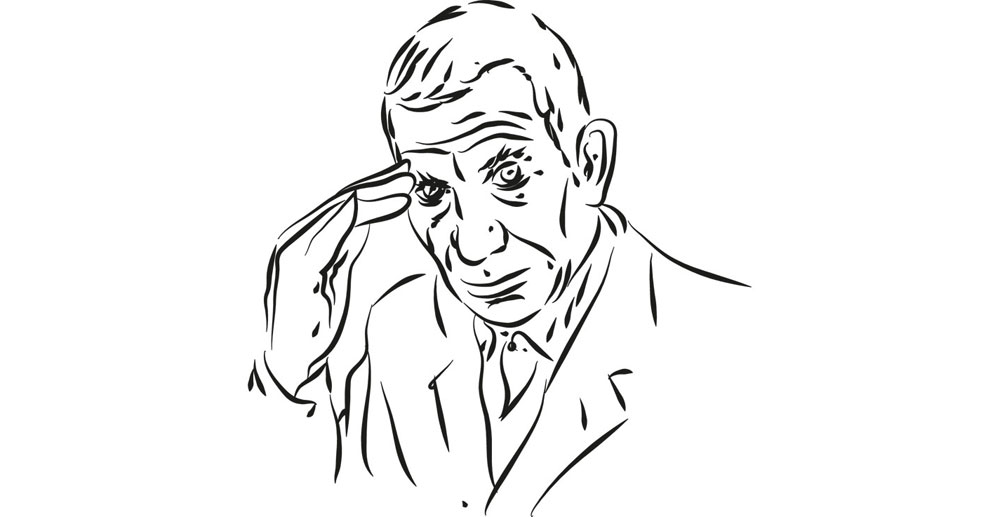
Sureau sur l’eau
C’est peut-être Michel Audiard qui a le mieux résumé l’affaire, lorsqu’il fit dire à Francis Blanche, dans Les Tontons flingueurs : « C’est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases ». Bien vu. Le marin est un littéraire d’imprégnation. Aux temps bénis de Pierre Loti et Claude Farrère, romanciers formés à l’École Navale, les présentations dans les cocktails parisiens s’en trouvaient nettement simplifiées : « Ah, vous êtes officier de marine ? Dans quelle revue ? » C’est dire si la littérature est casanière. Aujourd’hui, on peut même naviguer sans quitter ses pénates, relate François Sureau dès l’incipit de son formidable récit, L’or du temps, où le monde et l’histoire défilent comme saisis à travers le hublot d’une péniche houseboat, le long de la Seine, depuis les marches forestières de la Gaule profonde jusqu’au pont Mirabeau cher à Apollinaire, le guetteur mélancolique des modernes parapets.
Pour autant, le périple séquanais n’est jamais ici qu’un prétexte. Personnages, souvenirs et légendes fleurissent les berges d’un puissant fleuve narratif dont les méandres épousent ce qu’on eût appelé naguère le roman national, feuilleton à rebondissements où s’illustrent pêle-mêle le roi Babar et Blaise Cendrars, Descartes et Paul Meurisse, le cardinal de Richelieu et Isabelle Adjani, tout un panthéon de gloires et de controverses et dont François Sureau, récemment élu à l’Académie française, se révèle un logographe éblouissant, débordant de culture et d’esprit. Ce livre est surtout un monument élevé à la fraternité, le maître mot d’un lettré qui connaît les hommes, les chants des casernes et l’âme des chartreux. On y croise Simenon, capitaine au long cours tout à fait breveté, lui, sur son cotre l’Ostrogoth, entre Montereau et Samois, où il remisait son angoisse d’écrire. On y retrouve la fameuse noyée de la Seine au sourire de Joconde, qui était déjà apparue chez Rilke, Nabokov, Supervielle, Aragon et qui semble renouveler, sous la transe légère de notre collectionneur d’élégances, son bail dans l’éternité. Et toute rivière de bon format étant un appel à fendre l’horizon, on y rêve même à de grands voyages ultramarins, des fumeries de Phnom Penh aux cases rimbaldiennes de Tadjourah que François Sureau, colonel attesté de la Légion étrangère, a visitées dans ses vies d’autrefois.
Les livres de François Sureau, récemment élu à l’académie française,
sont des monuments élevés à la fraternité,
le maître mot de ce lettré qui connaît les hommes.
Le dernier à quitter le navire, au terme de la croisière, sera Apollinaire, l’écrivain selon son cœur, à qui Sureau adolescent s’identifiait déjà, copiant ses manières, sa faconde soldatesque et jusqu’à son rire de gorge, lui volant aujourd’hui avec le tact d’un disciple testamentaire ses secrets et ses tourments dans un splendide mémorandum, volume inaugural d’une nouvelle collection, « Ma vie avec… »
« Je suis comme ces marins qui dans les ports passent leur temps au bord de la mer, qui amène tant de choses imprévues, où les spectacles sont toujours neufs et ne lassent point », écrivait le flâneur des deux rives. François Sureau réussit la gageure de transformer la vie brève du poète ainsi qu’elle fut vécue : en aller simple dans l’inconnu. Dans la grâce du consentement, sans retour. Du temps qu’il mimait son idole, fumant une de ces pipes en terre qu’on voit aussi aux lèvres de Rimbaud et qu’on appelait des Gambier, François Sureau, l’année de ses quinze ans, chez les jésuites, avait gravé, à la pointe d’un canif, sur son pupitre en bois à Saint-Louis-de-Gonzague, cette promesse : « Mon bateau partira pour l’Amérique, et je ne reviendrai jamais. »
L’or du temps, par François Sureau, Gallimard, 848 p., 27,50 €
Ma vie avec Apollinaire, du même auteur, Gallimard, 162 p., 16 €




