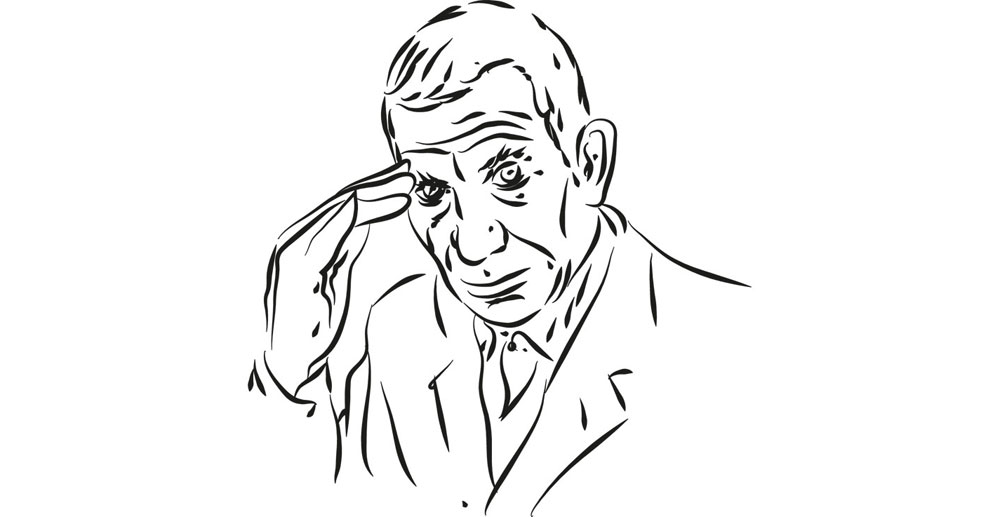
«La vie est trop courte, et Proust est trop long », se lamentait Anatole France au sujet de La Recherche du temps perdu. Et encore, l’auteur de Thaïs est-il mort trop tôt pour en voir le bout, il s’en faut même de deux forts volumes. C’est dire. Il n’empêche. Le jugement est brutal, venant d’un écrivain que Proust personnellement admirait fort – au point qu’il le prit pour modèle d’une des figures les plus impressionnantes de La Recherche, le majestueux Bergotte. Mais c’est ainsi et Marcel Proust, raillé en somme pas son personnage même, est devenu dans la légende le parangon du long, et sa phrase une métaphore moderne du labyrinthe antique où le lecteur serait, comme Thésée s’agrippant au fil d’Ariane pour n’en pas perdre l’issue, un passager en sursis.
Aussi est-il plaisant de découvrir sur la grève, à présent que s’est retirée la marée des ouvrages de célébration publiés pour le récent centenaire du romancier le plus long, le livre le plus petit du monde, le plus court, le plus humble ayant jamais paru sous la signature de Marcel Proust : il ne compte pas plus de douze pages ! Et s’intitule, on vous le donne en mille, La Mer, un texte extrait des Plaisirs et les jours, le recueil qui en 1896 préfigurait le monument à venir… et qu’avait préfacé à l’époque Anatole France. C’est donc un peu plus qu’un livre : un talisman, un bijou (composé et façonné selon les règles de la typographie au plomb, à l’ancienne). Proust a écrit magnifiquement de la mer, sa compagne domestique et sauvage, depuis la fenêtre de sa chambre à Cabourg, tout le temps que lui prit son grand œuvre : « La mer a le charme des choses qui ne se taisent pas la nuit, qui sont pour notre vie inquiète une permission de dormir, une promesse que tout ne va pas s’anéantir, comme la veilleuse des petits enfants qui se sentent moins seuls quand elle brille ». On ne va pas non plus tenir le génial Marcel pour le Conrad du pays d’Auge, quand sa grande aventure consiste à rentrer enrhumé à l’hôtel pour s’être trop longtemps extasié au crépuscule devant une apparition de l’actrice Lucy Gérard, dont il regarde s’éloigner la robe rose sur la digue, gonflée « comme une voile enchanteresse ». Et s’il lui arrive de perdre pied, ce n’est pas sur le pont d’un bateau balancé par les houles redoutées de la Manche, mais à la table de baccara du casino où il laissera une part estimable de sa fortune. La mer, il la voit surtout comme la consolation des affligés, le plus souvent avec humour, ainsi qu’il convient à un écrivain mélancolique et d’expression balnéaire : par exemple, il se verrait bien se jeter à l’eau si « cet orchestre de grosses femmes, jouant des valses au cor de chasse », devait continuer de lui gâter les couchers de soleil, et, à la question de Léon Daudet demandant s’il avait eu des marins dans sa famille, il aurait volontiers fait sienne la réponse que lui fit Pierre Loti (autre passion littéraire du jeune Proust) tant elle le fit rire : « Oui, j’ai eu un oncle qui a été mangé sur le radeau de la Méduse ».
La mer, c’est la magie, c’est l’absolu du mystère, c’est tout ce qu’on ne peut pas feindre de connaître et Marcel Proust s’en est beaucoup servi dans La Recherche – ainsi pour se moquer de la très snob marquise de Cambremer, toujours empressée de son ignorance, à qui il fait déclamer pathétiquement, devant un vol de mouettes qu’elle prend pour des albatros : « Leurs ailes de géants les empêchent de marcher ». Là où elle n’aurait pas tort cependant, c’est que Proust, ses ailes de géant ne l’empêchent pas de tenir dans le plus simple opuscule. ◼
La Mer par Marcel Proust, Les Petites Allées, 12 pages, 9 €. Disponible sur commande via le site <lespetitesallees.fr>




