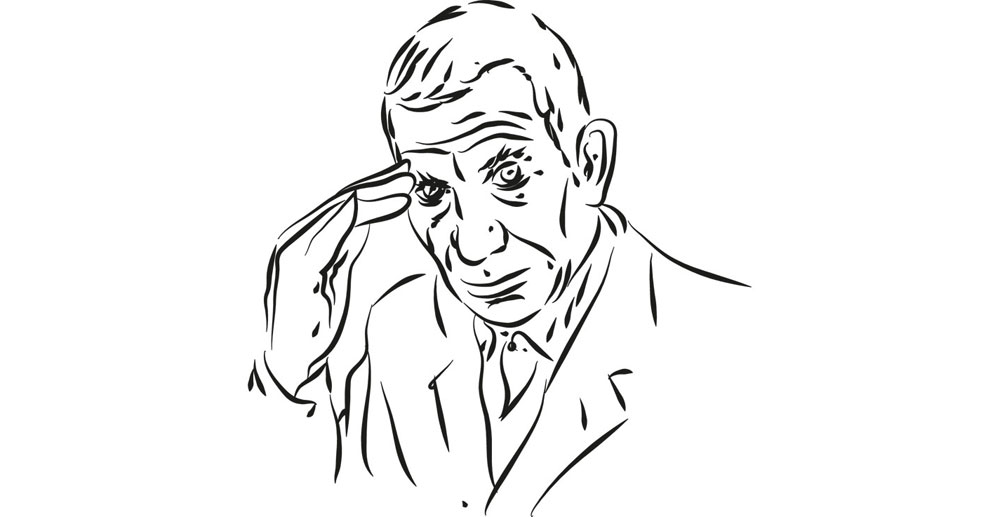
Modiano blues
«T’as voulu voir Anvers, on n’a vu qu’ses faubourgs », chantait Brel autrefois. Il faut dire que là-bas, le port est si vaste qu’il cache la mer. Sur les terres plates de l’estuaire, l’Escaut se répand comme le vin sur la nappe du repas de noce, dans le tableau de Brueghel l’Ancien, et la mer n’est plus qu’une hypothèse, invisible et lointaine, que les navires traînent paresseusement derrière eux. Pas de sirène ici rêvant sur son rocher à son royaume pélagique. Devant l’hôtel de ville, un docker de bronze, debout, les mains sur les hanches, semble reprendre son souffle. C’est un mémorial érigé à la souffrance des hommes. Ce portefaix, saisi dans un répit plus éloquent que l’effort, est l’arrière-grand-père maternel de Patrick Modiano. Du moins a-t-il posé pour cette statue, signée de Constantin Meunier, un peintre et sculpteur que Van Gogh plaçait au-dessus de tous, lui-même compris. Le docker d’Anvers, parfois nommé le débardeur, est débité en figurines pour la postérité. Il s’appelait Louis Bogaerts. Il notait dans son loonboek (son livre de paie), les noms des bateaux qu’il déchargeait : le Michigan, l’Elisabethville, le Santa Anna… C’est la première velléité de littérature dans la généalogie du futur prix Nobel. Louis Bogaerts est mort au travail, vers soixante-cinq ans, en faisant une chute.
« Tous mes livres sont des bouteilles à la mer », dit le prix nobel de littérature 2014, qui revient à sa jeunesse dans « chevreuse », son nouvel opus.
Native d’Anvers, sa petite-fille, la mère de Patrick Modiano, s’appelait Louisa Colpeyn. C’était une actrice de théâtre qu’on a vu jouer dans tous les ports de l’Atlantique et de la Manche. Le père de l’écrivain, insaisissable affairiste qui donnait ses rendez-vous au Claridge, avait étudié le droit maritime et s’était commis à maints projets improbables, comme la mise en chantier d’un pétrolier en forme de cigare. Cet Albert Modiano était lui-même le fils d’un aventurier qui avait quitté Salonique pour les îles caraïbes, où il s’adonna au commerce des perles. On voit par là que si l’auteur de Rue des boutiques obscures est perçu, à juste titre, comme un romancier des villes, des quartiers, des boulevards, son œuvre tout entière baigne dans les non-dits d’une conjoncture maritime, un tourbillon de souvenirs flottants et de vies à la dérive, échouées au hasard des rivages, là où les porte le ressac. « Tous mes livres sont des bouteilles à la mer », dit lui-même Modiano. Simplement, la mer, dans ses livres, on ne la voit pas. Elle est invisible. Comme à Anvers. C’est le continent toujours recommencé de l’oubli, de la perte, de l’absence.
Aujourd’hui, le plus illustre de nos écrivains revient à sa jeunesse dans Chevreuse, qui se présente comme une variation romanesque du récit autobiographique qu’il avait publié en 2005, Un pedigree. On y retrouve, sous d’autres noms, les personnages incertains qui naviguaient au lendemain de la guerre entre la porte d’Orléans et la vallée de l’Yvette, fuyant on ne sait quelle mauvaise intrigue, dans une principauté de bois et d’étangs, autour de la maison de Jouy-en-Josas où vécut l’auteur, enfant. On y croise un mystérieux Michel de Gama, dont on se demandera, avec Bosmans, un double de Modiano revenu hanter les lieux un demi-siècle plus tard, s’il n’est pas un parent du célèbre navigateur portugais. Qu’importe, puisque le génie du romancier consiste à souffler la poussière du temps sur la clarté des indices, ruinant ainsi tous les dogmes. Comme dans Encre sympathique, fiction désormais rééditée, où, dans les échos assourdis du Dancing de la Marine et le sillage du ressouvenir, se laisse entrevoir un monde englouti. « Seules les traces font rêver », disait René Char.
Chevreuse, par Patrick Modiano, Gallimard, 158 pages, 18€
Encre sympathique, du même auteur, Gallimard, coll. Folio, 102 pages, 6,30€




