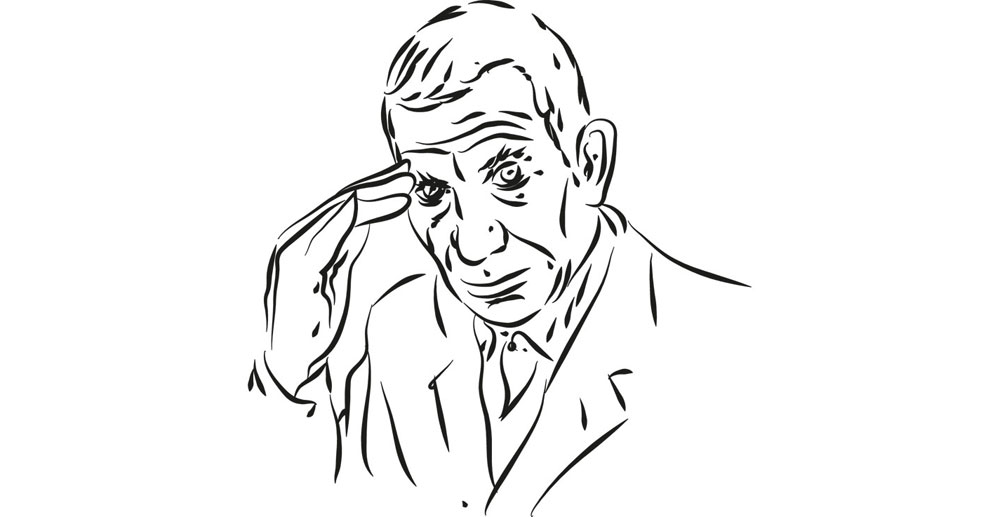
Le Condottière fait des vagues
L’emprise de la mer sur certains écrivains est telle qu’elle les arrache à leur moi terrestre. Les éparpille à tous les vents. Voyez André Suarès (1868-1948), rendu célèbre par son Voyage du Condottière. Né à Marseille, où son père était courtier en café auprès des compagnies maritimes, descendant d’une famille juive portugaise longtemps installée à Livourne, ce grand poète n’eut de cesse d’effacer, bannir, renier ses origines. Pour ce qui est d’aimer la mer, il était servi par sa naissance. Mais non, il détesta. Quand il évoquait ses racines, il parlait même de « l’horreur du berceau ». Ce qu’il voulait, lui, ce n’est pas la Méditerranée, ce n’est pas « ce toit tranquille où marchent des colombes » aimablement chanté par son confrère de la Nouvelle revue française Paul Valéry (qu’il détestait aussi, et qui le lui rendait bien, mais passons). Suarès voulait plus, il voulait l’océan brasseur de tempêtes, exerçant ses furies sur un coeur de granit. Il s’inventa breton, prétendit se retirer dans un vieux manoir imaginaire, se bricola de toutes pièces une parentèle irlandaise et celtique via un échantillon d’ancêtres toscans échoués par force sur les rivages ligures et signa ses textes Caërdal. Un pseudonyme nettement moins sensuel que Suarès.
On n’avait encore jamais eu
l’idée de réunir en un volume
les textes passionnés que
la mer inspira à André Suarès.
Pareille fabulation n’avait rien d’une anecdote en ce temps-là, où prévalaient, pour juger d’une oeuvre littéraire, son attache à l’intime, ses sources domestiques, en somme le nid (social et géographique) où elle avait été pensée. Il n’est qu’à songer au canular que, par lassitude devant la généralité des confessions périnatales, avaient imaginé au lendemain de l Grande Guerre Pierre Benoit et ses amis (Roland Dorgelès,
Francis Carco, Pierre Mac Orlan). Ils avaient fondé une académie dont le dessein premier était de distinguer le plus mauvais livre de l’année. Le prix consistait en un billet de train pour permettre au lauréat de rejoindre son giron natal, accompagné d’une lettre de félicitations fort amène où il lui était expressément recommandé de ne jamais en revenir.
Ce cercle secourable aux écrivains en cale sèche s’appelait très opportunément « le bassin de radoub » – par une heureuse métaphore qui augmente encore, s’il est possible, la contribution décidément inestimable de la marine à la littérature française. Bien entendu, André Suarès n’avait rien pour attirer le déshonneur d’un retour précipité au bercail : trop doué, trop créatif, il était l’auteur d’une oeuvre profonde, si abyssale même que Pierre Benoit lui dédia son roman-culte L’Atlantide. Et Marseille dut attendre que le Condottière, alias Jan-Félix Caërdal, alias lord Spleen (une autre de ses doublures), eût atteint les rivages de la vieillesse pour recevoir, dans Marsiho, l’hommage d’un remords tardif et d’ailleurs, ambigu. Il restait à recoller les morceaux d’une passion aussi déchirante pour le grand large : c’est le but poursuivi et atteint dans cette anthologie par Antoine de Rosny qui, tel le dieu Triton faisant sonner sa conque sur les flots, bat le rappel des pages maritimes, poèmes, lettres ou récits que la Bretagne, la Provence et l’Italie ont pu inspirer à l’auteur de Landes et marines. Sans oublier la Grèce, ni le Chili, Saigon ou Manille dont l’entretient dans ses courriers son frère Jean tant aimé, officier de la Navale qu’il a assisté dans ses concours, à Toulon, et qui lui offre depuis les lointains la procuration du rêve. Car la mer, pour André Suarès, c’est d’abord le vagabondage de l’esprit, l’errance du coeur, une puissance de solitude qui ouvre sur l’infini. Elle n’a « rien pour l’espoir, rien pour la vie », écrit-il. Elle s’abstrait de ces registres. « Elle m’est connue comme si j’en étais sorti, et souffle en moi l’haleine de la grande rêverie. » ◼
Ports et rivages, par André Suarès, anthologie, Gallimard, 380 pages, 25 €




