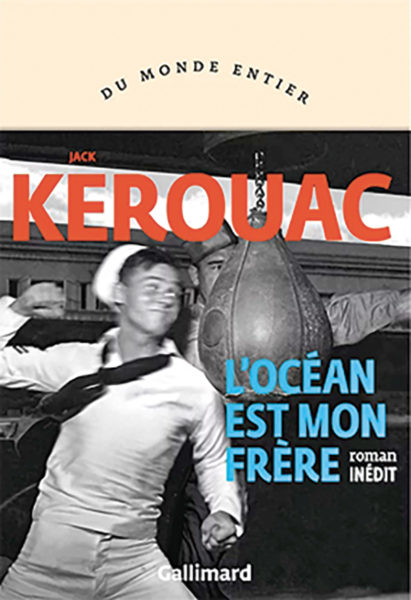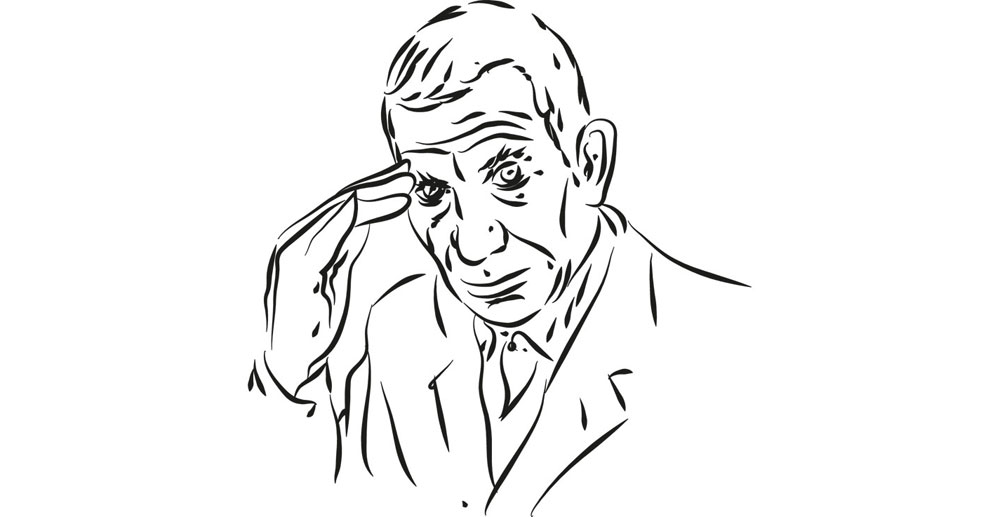
C’est plus qu’un événement : un miracle. Un peu comme de voir rentrer au port un navire qu’on annonçait perdu. C’est même deux fois une surprise : d’abord, il est rare qu’on découvre dans un tiroir, plus de cinquante ans après la mort d’un écrivain légendaire, un roman gisant dans des splendeurs jamais contemplées, abandonné à l’oubli. Il est plus rare encore que cette découverte modifie ou retouche l’image que ledit écrivain a laissée à la postérité. Dans la fable hollywoodienne qui le résume, Jack Kerouac c’est le vagabond solaire et inspiré de Sur la route, un terrien chaussé pour la vadrouille, le lyrisme des piètres et de la maraude à l’américaine, coast to coast, tous les errements. Lui-même se voyait drôlement comme un « running Proust », un polygraphe coureur de routes plutôt que cloué aux fièvres et aux extases immobiles de son lit de souffrance.
Et voilà que l’homme aux semelles de poussière, l’auto-stoppeur le plus célèbre de la « Beat Generation », ainsi qu’il qualifia lui-même la remuante église dont on le fit pape, nous revient par la mer, la mer dont on se rend compte qu’elle fut la passion contrariée de sa jeunesse, aussitôt reniée que consommée. L’affaire dura deux ans, pendant la guerre, et lui dicta ce premier roman, L’océan est mon frère, qui est tout sauf le livre d’un débutant. « What a strange call I hear from the sea ! », écrit-il à sa petite amie de l’époque. Il n’a pas vingt ans, et décide de s’engager dans la Marine. « Quel étrange appel j’entends en provenance de la mer ! Peut-être mes ancêtres, des pêcheurs bretons, s’agitent-ils dans mon sang. Peut-être suis-je fatigué d’une vie ennuyeuse et banale. Peut-être suis-je fou. Mais je dois partir. »
En fait, derrière l’intimation fantomatique des aïeux, ce que le taciturne Kerouac demande à la mer, c’est de sublimer sa vocation d’écrivain, qu’il sait impérieuse depuis son adolescence, sans savoir encore à quels motifs l’accrocher : « Si je ne reviens pas, c’est que je n’étais apparemment pas destiné à devenir un grand écrivain. C’est la raison pour laquelle je vais revenir ». Le futur auteur des Clochards célestes embarque au printemps 1942, à Boston, sur le SS Dorchester à destination de Mourmansk, en mer Blanche soviétique. Ce vapeur, réquisitionné au début du conflit, est exploité par la War Shipping Administration (WSA) pour le transport de troupes. Hormis une escale au Groenland, la rencontre d’un Inuit dans un fjord et la camaraderie avec un cuistot du bord surnommé « Old Glory », qui mourra lors du torpillage du Dorchester, l’expérience n’est pas à la hauteur des ambitions littéraires du matelot. Il n’aura de cesse de rompre son contrat avec l’US Navy, jusqu’à simuler la folie et se laisser enfermer dans un hôpital psychiatrique. Finalement, il est renvoyé de la Marine pour « instabilité et indifférence caractérisées ».
C’est alors qu’il écrit The sea is my brother, qui ne lui plaira pas non plus, bien que cette fiction, relatant l’amitié d’un marin taiseux et d’un bavard diplômé de l’université de Columbia, qui sont comme deux facettes de l’auteur lui-même, ait le mérite de peindre avec une bouleversante exactitude l’ambiance de ce voyage agité, entre conversations métaphysiques, beuveries d’escales, parties de cartes et alertes aux torpilles allemandes. Jack l’insatisfait remisa pourtant le manuscrit, inachevé, que l’on déclara à jamais perdu avant que son beau-frère ne l’exhume du néant. Et que le fantôme de Kerouac ne vienne s’enchaîner sur le pont du Dorchester à tous ceux qui l’y avaient fait monter.